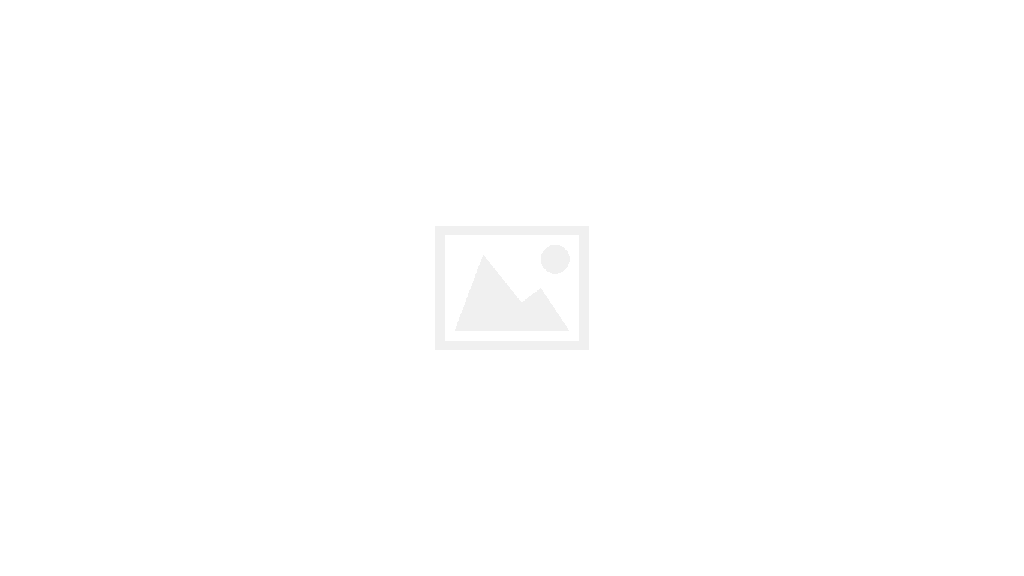La population de la Martinique comptait 328000 habitants en 1982. Ce chiffre s’élevait à 375000 habitants estimés en 1993. En dix ans, la population a augmenté de 42000 personnes, ce qui est considérable. Cela s’explique par l’accroissement naturel important en raison d’un taux de natalité encore élevé (17,8‰) et d’un taux faible de mortalité (6,5‰). De plus, le solde migratoire est devenu positif, alors que pendant la décennie précédente il était négatif : les départs étaient plus nombreux que les arrivées.
La partie sud de la Martinique semble être plus attractive : plus de 15000 nouveaux habitants sont venus s’y fixer pendant les dix dernières années, en particulier à Ducos, au Diamant, aux Trois-Ilets. A l’inverse, quatre communes du nord de l’île se sont dépeuplées : Saint-Pierre, Fond-Saint-Denis, Macouba et Grand-Rivière. La densité moyenne actuelle est de 327hab./Km². L’agglomération de Fort-De-France est toujours un pôle d’attraction. La ville a dépassé, depuis 1990, les 100000 habitants, et les villes qui l’entourent enregistrent une forte croissance. L’expansion périurbaine a profité aux communes de Schœlcher et de Case-Pilote et s’étend même au carbet.
La population estimée de la Martinique est aujourd’hui de 411 000 habitants, pour une densité moyenne de 227 habitant au Km² (en 1990). Composée essentiellement de noirs ou métis (près de 80 %), originaire d’africains en provenance des côtes guinéennes pour les besoins de la culture de la canne à sucre pendant les XVIIème et XVIIIème siècle.

A. Césaire, Le Nègre Fondamental
Les principales villes sont : Fort-de-France le chef-lieu, Le Lamentin et Schoelcher.
La société martiniquaise témoigne de l’histoire du long métissage de divers groupes humains. Cette diversité de la population se traduit par l’existence d’un folklore coloré, popularisé en Europe et en Amérique du Nord par des groupes de danseurs et de chanteurs.
La personnalité martiniquaise se traduit aussi dans la cuisine colorée et souvent pimentée qui mêle les influences françaises, africaines, espagnoles et asiatiques.
La plupart des Martiniquais sont catholiques. D’autres communautés religieuses sont cependant présentes : Eglise adventiste, Témoins de Jéhovah, etc…
Les Indiens des Indes : A ne pas confondre avec les indiens caraïbes, malgré les ressemblances physiques. Ils sont quelques dizaines de milliers en Martinique. Malgré une certaine créolisation de leur mode de vie, les coolies ont réussi à conserver de nombreux éléments de leur patrimoine culturel. Les temples hindous se repèrent aisément dans la campagne par la présence de mats tricolores arborant les drapeaux rouges et bleus et sous lesquels des réceptacles accueillent offrandes, bougies et lampes à huile.

Les Békés : Peu nombreux, ils forment une véritable caste, les noms des grandes familles se retrouvent sur les façades de la majorité des grandes entreprises de la Martinique. Ils contrôlent toujours en grands seigneurs la charpente économique de l’île : la culture et le commerce de la banane, du sucre de canne, du rhum, ils ont su aussi diversifier leurs activités.
Les Libanais et les Syriens : Ils forment comme partout ailleurs une communauté dont l’activité essentielle est le commerce, et détiennent dans l’île, la majeur partie des magasins de bijoux, de tissus et de vêtements, notamment dans les grandes rues commerçantes de Fort de France.